
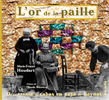 .
. 
De la tresse au cabas en pays de Beynat
de Marie-France Houdart
Préface de Claude Duneton
ISBN : 9 782-9-16 512 -08-2
Prix : 26 euros
L' auteur
Préface
Introduction
Quelques pages
La table des matières
cabas ?
animations et rencontres
pour commander cet ouvrage
- Introduction (suite) : Le cabas
au pays de Beynat
3. Le pays de Beynat
a/ Quelques éléments géographiques
Le pays de Beynat constitue une enclave de terres hautes (au-dessus
de 500 m), et acides que l’on dit pauvres : peu de terres labourables,
beaucoup de landes, de chataigneraies…, que se partagent une infinité
de tout petits propriétaires. Et, pour compléter, de grandes
surfaces de communaux ou plutôt de “sectionnaux“ où, à
condition de les dépouiller de leur bruyère, chacun peut
semer son “blat“, son seigle. Oui, le pays du cabas est une terre à
seigle. Dès que l’on descend, on entre en pays de blé. Et
alors c’est fini, le cabas ne se fait plus, ou si peu. La relation s’établit
vite. Trop vite ?

Pays défavorisé, mais favorisé aussi, qui ne se
comporte pas comme les autres pays hauts et pauvres, mais qui n’a pas non
plus les moyens de se laisser aller comme les plaines plus calcaires du
bassin de Brive ou de la douce vallée de la Dordogne, si proches.
A égale distance de deux villes, la Préfecture et la riche
Sous-Préfecture, juste au-dessus de la vallée, et sur le
rebord du plateau qui descend vers le Causse, et vers le sud-ouest, Toulouse,
l’Espagne, oui, le “pays de Beynat“ est un pays à part. 
b/ Quelques spécificités historiques
Alors l’Espagne… Et si, le cabas, c’était justement l’Espagne.
Car le pays du cabas c’est aussi celui que l’on quittait, du XVIe jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle, pour aller exercer à Cadix toutes
sortes de métier de peine auxquels les Espagnols enrichis par la
conquête de l’Eldorado ne voulaient plus s’abaisser. De là
à penser que l’un de ces “Espagnols“ l’aurait rapporté de
là-bas… Encore une histoire à laquelle, ici, l’on croit ferme.

Histoires d’un autre âge, pour les nostalgiques de ce “A l’époque…“
Elles auraient pu en rester là, à l’état de mythes
ou de folklore révolu, à l’image de toutes ces “paysannes
corréziennes“ du siècle dernier représentées
un cabas au bras, si…
4. « A temps retrouvé »
Les gestes étaient encore là, au bout des doigts, et
qui démangaient. En ce temps de remise en cause de ce modèle
économique qui commença par faire mourir cabas et cabatiers,
de réflexion sur les bons gestes à faire pour moins gaspiller
: refus des emballages perdus, bannissement du plastiqueé, retour
du recyclage et de la récupération…, ah si l’on pouvait…
ces tresses de paille… ces cabas que l’on faisait…

Certains commençaient à y penser. Mais il faudrait une
légitimation, en quelque sorte, une réhabilitation de ces
pauvres vieux cabas tressés par nos vieilles et qui achevaient leur
vie, mangés par les souris dans un coin de la grange. Combien en
avait-on jeté du reste, de même que tous ces outils périmés,
et tout récemment encore, en “débarrassant“ à la mort
du père ou de la mère. Voilà maintenant qu’il fallait
les retrouver ! Pour en refaire ? Pour leur consacrer un livre ? .
“ L’or de la paille “ ? C’est vrai que la paille, c’était de
l’or. L’enthousiasme avec lequel le titre a été accepté
montre que ce qui était attendu, c’était cela. Comme si le
cabas retrouvait soudain des “lettres de noblesse“.
Mais comment ne pas décevoir ? D’abord écouter, faire
parler, encore et encore, pour que les témoignages se croisent et
se recroisent, quitte à se contredire, en transcrivant tout, en
confortant les opinions comme en cassant les certitudes, en jouant le jeu
de la recherche.
Une fois établi ce dont on se souvient le plus, alors viennent
les “pourquoi ? par qui ? quand ? comment ? “.
Alors, allons-y, enquêtons ensemble. L’enquête s’avère
passionnante.

