
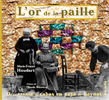 .
. 
De la tresse au cabas en pays de Beynat
de Marie-France Houdart
Préface de Claude Duneton
ISBN : 9 782-9-16 512 -08-2
Prix : 26 euros
L' auteur
Préface
Introduction
Quelques pages
La table des matières
cabas ?
animations et rencontres
pour commander cet ouvrage
- Introduction (suite) :Qu’est-ce
qu’un cabas ?
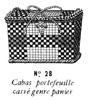

2. Qu’est-ce qu’un cabas ?
1/ Quelques définitions
Une définition, d’abord, empruntée au Dictionnaire encyclopédique(…)
des arts industriels (1881-1891) de Lami et Tharel (2) :
Cabas : « Sorte de panier en jonc tressé, en feuilles
de palmier, ou en sparterie, et qui, dans le Midi, sert à emballer
des fruits secs.//Par analogie, on donne le même nom à une
sorte de panier aplati, à anses, fait en paille tressée ou
en point de tapisserie, et dont les femmes se servent pour mettre leurs
menus ouvrages ou leurs emplettes. »

Consultons maintenant une source plus proche de nous, le Dictionnaire
du Patois du Bas-Limousin (et plus spécialement des environs de
Tulle), de Nicolas Béronie, paru en 1823, où l’orthographe
“coba“ est fidèle à la prononciation locale.
« Coba, s.m. Espèce de panier de jonc qui sert à
mettre des figues, des raisins secs. - Cabas, s.m. Ce mot est Prov. et
Langued. Le nôtre est fait de paille, et on s’en sert principalement
pour porter la viande de boucherie ». (B.)
Les deux dictionnaires sont donc d’accord sur l’origine méridionale
du mot. associé aux fruits secs. Nous apprenons aussi que le “cabas
fait de paille“ était bien connu en 1823 vers Tulle, mais pour transporter…
la viande (!?) (3). Aucune référence, en revanche, ni à
Beynat, ni à une utilisation paysanne.

2/ Un peu d’étymologie
On fait généralement venir le mot “cabas“ du latin capax,
qui veut dire “capable de contenir“, du verbe capio, qui signifie lui-même
: “prendre“, puis “contenir“. On est bien dans l’idée première
de nos paniers qui servaient à prendre, puis contenir ce que l’on
avait pris à la nature pour s’en nourrir. Le mot latin (venu lui-même
d’une très vieille racine) est passé au français par
l’intermédiaire du provençal qui l’a donné au limousin.

3/ Matière et technique
Fait de fibres végétales - ou de “tapisserie“ -, la particularité
du cabas est en tout cas d’être souple. La technique mise en oeuvre
est de ce fait intermédiaire ente la vannerie et le tissage :
- la vannerie, parce qu’il s’agit de fibres intriquées,
- le tissage, parce que ces fibres, tressées, sont ensuite tissées
autour d’un gabarit de bois, bien que ce “moule“ sur lequel sont tendues
les tresses de chaîne, ne fasse que donner la forme et n’ait rien
d’un “métier“ (4).
Mais, du tissage et des tissus, il a gardé le croisement de
la chaîne et de la trame ce qui offre la possibilité de jouer
sur les couleurs : à nous les diagonales, lignes, bandes, damiers,
los“ et “cabatières“ en ont joué et y jouent à l’infini,
faisant du cabas un panier reconnaissable entre tous.

2. Les études existantes
Elles se résument à des passages d’ouvrages, comme celui
que l’on trouve sous la plume d’Emile Charlot, beynatois bien connu, dans
Histoire et légendes, Beynat et Roche-de-Vic. Ce n’est pas une étude
sur le cabas mais nous ia avons trouvé de très précieux
renseignements. De nombreux articles ont bien été consacrés
au sujet, mais ils ne font souvent que se répéter. Faisons
une place à part au reportage de Jean et Micheline Ribière,
journalistes-reporters, sur “La fabrication des cabas de Beynat“ vers 1958
(5). Et une autre mention de choix au roman Le monument, où Claude
Duneton consacre de belles pages à la tresse de paille.
Le sujet intéressa aussi une jeune élève institutrice
de l’Ecole Normale de Tulle, Colette Monéger, qui en fit son sujet
de Mémoire en 1959 (6). Ce travail donne de nombreuses données
sur la situation du cabas en ce temps-là : économie, entreprises,
matière première... Il est remarquable pour sa préentation
et sa magnifique couverture de paille tressée.
Le cabas et le pays de Beynat .....

